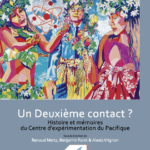
Un deuxième contact ? Histoire et mémoires du CEP
Sous la direction de Renaud MELTZ, Benjamin FURST et Alexis VRIGNON
1963. Le Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP) est officiellement créé.
1966. Aldébaran est le premier des 193 essais tirés en Polynésie française. À Paris comme à Tahiti, tous s’accordent à prévoir que cette entreprise militaroindustrielle va bouleverser la société, l’économie et la culture locale.
Pourtant, cette histoire a d’abord retenu l’attention des historiens sur les intentions de l’État et ses moyens d’actions. Les dix-huit contributrices et contributeurs de cet ouvrage entendent proposer une nouvelle approche avec la conviction que le CEP constitue un « deuxième contact » en Polynésie française. Cette notion permet de ne pas restreindre l’histoire des essais aux seuls sites de Moruroa et Fangataufa, alors que toute la Polynésie a été nucléarisée. Elle fait droit à la capacité d’action des Polynésiens, acteurs de cette vaste entreprise nucléaire en dépit de l’asymétrie des forces en présence, qu’il s’agisse du choix du site, de la gestion des risques ou des relations avec les pays de la région. Le CEP ne s’est pas fait sans les Polynésiens. On peut dire qu’il a été réalisé tout à la fois malgré eux, avec eux, contre eux. Le CEP a contribué à l’essor du salariat polynésien, à l’intensification des migrations inter-îles, à la diffusion de nouvelles formes de loisir, à la généralisation de l’usage du français. Il a également alimenté des tensions et des interrogations quant aux conséquences sanitaires et environnementales des essais et conditionné la vie politique. Explorer le « deuxième contact », c’est être guidé par la conviction que les Polynésiens n’ont pas été de simples figurants mais des acteurs essentiels de cette histoire, qui a également transformé la trajectoire des Européens qui y ont pris part.
